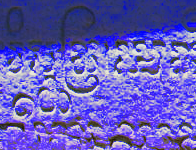
« Les lois oppriment seulement ceux qui ne songent pas à les enfreindre; en revanche, elles n’ont jamais été un obstacle pour ceux qui sont décidés à ne subir aucune contrainte.«
Historiquement, la bureaucratie est sortie du bailliage. Le scribe qui, dans un bureau, traite grossièrement le citoyen appelé devant lui, est l’héritier du prévôt ou surveillant qu’un despote, aux siècles de ténèbres, plaçait au-dessus de son peuple d’esclaves pour maintenir celui-ci dans l’obéissance, à l’aide du fouet et de la lance des cavaliers de sa garde du corps. L’employé étant une particule de la grâce de Dieu, revendique pour lui- même infaillibilité divine il est au-dessous du chef suprême de l’État, mais au-dessus des gouvernés. Ceux-ci étant le troupeau dont le chef de l’État est le pasteur, l’employé est le chien de berger. Il a le droit d’aboyer et de mordre, et les moutons doivent le subir. Et les moutons le subissent aussi !
Le citoyen ordinaire -celui de l’espèce de mon Jean – entre pleinement dans les idées de l’employé. Il lui reconnaît le droit de commander et accepte pour lui le devoir d’obéir, il se rend auprès de l’autorité, non comme pour réclamer ce qui lui est dû, mais comme pour implorer des faveurs. Il serait, du reste, insensé de vouloir se cabrer contre cette situation paradoxale, car, dans une lutte avec l’employé, celui-ci resterait probablement vainqueur, et même, au cas le plus favorable, les intérêts du citoyen subiraient pendant la durée de la lutte des délais et de graves atteintes de tout genre. La fiscalité a pour pendant le mandarinisme; tous deux sont des déductions logiques de la conception d’un maître par la grâce de Dieu et d’un assujettissement par le courroux de Dieu.
Aujourd’hui, comme il y a des siècles, la législation est complètement sous l’influence de la fiscalité et du mandarinisme. Sur cent lois faites, soit avec le concours du peuple, soit sans lui, il y en a sûrement quatre-vingt-dix-neuf qui n’ont pas pour but d’accroître la liberté d’action et les agréments de l’existence du citoyen, mais de faciliter aux baillis et aux gens du guet l’exercice des droits souverains qu’ils se sont arrogés. On nous soumet à mille désagréments, afin que l’employé puisse gouverner et percevoir les contributions plus commodément. On nous marque, comme les bêtes d’un troupeau, avec des numéros et des lettres, afin qu’on puisse plus facilement nous parquer et nous exploiter. On nous punit tous a priori en nous faisant subir des restrictions vexatoires, parce que l’un de nous, exceptionnellement, pourrait une fois dépasser les bornes. Dois-je le prouver par des exemples? Tous les marchands sont forcés de tenir leurs livres d’une façon déterminée, exactement prescrite par la loi. Pourquoi? Parce que l’un d’eux peut être coupable un jour de banqueroute frauduleuse et que le juge d’instruction n’est à même de se rendre compte de l’état des choses que si toutes les affaires sont portées très soigneusement à la place prescrite. S’il n’y avait pas de livres, ce magistrat aurait fort à faire pour voir clair dans le dédale des opérations commerciales. Pour lui épargner cette peine, que lui donnerait une banqueroute, la loi enlève la liberté de mouvement à cent marchands qui ne pensent nullement à léser les intérêts de leurs créanciers.
Chacun de nous, dans les grandes villes notamment, doit informer respectueusement la police de ses allées et venues. Pourquoi ? Parce que l’un d’entre nous pourrait commettre un jour quelque méfait qui le ferait rechercher par la police; on le trouvera plus facilement si tout le monde est obligé d’indiquer à celle-ci la demeure de chacun. Pour s’épargner, le cas échéant, la peine des recherches en vue desquelles, cependant, elle est payée, la police nous impose continuellement la nécessité de faire des déclarations. Je pourrais centupler ces exemples, si tous ne se ressemblaient pas.
Tout cela n’empêche pas que les limites imposées par l’État aux citoyens manquent complètement leur but. Les lois oppriment seulement ceux qui ne songent pas à les enfreindre; en revanche, elles n’ont jamais été un obstacle pour ceux qui sont décidés à ne subir aucune contrainte. Le bigame commet son crime malgré les formalités qui rendent à l’homme honnête le mariage coûteux et plein d’entraves. Le bandit porte sur lui couteau et revolver, en dépit des prescriptions qui interdisent aux citoyens paisibles le port d’armes sans autorisation. Il en est de même en toutes choses. C’est toujours le système d’Hérode faisant tuer tous les enfants mâles, parce que l’un d’eux pourrait devenir un prétendant au trône, et laissant naturellement échapper à la boucherie celui qui, précisément, peut être dangereux.
La conception philosophique de l’État a changé aujourd’hui. La situation des citoyens, par rapport à l’État, est devenue théoriquement celle d’un associé à une compagnie. Toutes les constitutions, depuis 1789, parlent du principe de la souveraineté du peuple; mais, dans la pratique, la machine de l’État est restée la même : elle travaille aujourd’hui tout comme à l’époque la plus sombre du moyen âge, et si sa pression sur l’individu est devenue moins forte, il ne faut y voir qu’un résultat de l’usure de la machine. La prémisse sous-entendue dans toutes les lois et tous les règlements, c’est, après comme avant, que le citoyen est la propriété personnelle du chef de l’État, ou du moins de ce fantôme impersonnel nommé l’État, qui a hérité de tous les privilèges des anciens despotes, et qui a pour incarnation visible les « autorités ».
L’employé n’est pas un chargé d’affaires du peuple, mais le représentant de la puissance de l’État placée au-dessus de lui; c’est l’ennemi, le surveillant, le geôlier du peuple.
Les lois sont faites pour permettre à l’employé de défendre les intérêts de son maître réel ou abstrait, le monarque ou l’État, contre le peuple, qu’on suppose a priori vouloir se débarrasser de son maître. Celte idée explique seule la considération dont le mandarinat continue à jouir de nos jours et la large place qu’il occupe dans l’État. L’employé ne peut imposer à la foule par de riches traitements, ni par son faste; il ne peut prétendre au respect des nobles esprits par une culture supérieure et de grandes facultés; les utilitaires ne peuvent certainement regarder son travail comme plus utile que celui des classes directement productrices : les agriculteurs, les ouvriers, les artistes, les savants. Si donc la qualité d’employé n’est synonyme ni de gros revenus ni de culture intellectuelle et de facultés spéciales, comment attache- t-on à celte situation une considération que n’obtient aucune autre? Pourquoi? Parce que l’employé est une partie de l’autorité souveraine que le peuple regarde inconsciemment, par habitude héréditaire, comme quelque chose de mystérieux, de surnaturel, provoquant le respect et l’effroi. La grâce de Dieu qui illumine le roi rayonne aussi sur l’employé ; une goutte du saint-chrême qui sanctifie le monarque lors de son couronnement tombe aussi sur le front du fonctionnaire. Celte idée continue à régner même dans les pays qui n’ont plus de roi, plus de couronnement, plus de grâce de Dieu. Elle est devenue une action réflexe de l’âme populaire.
Que fait maintenant le parlementarisme ? Ne rend-il pas à l’individu la liberté de mouvement que lui ont enlevée la fiscalité, le mandarinisme et la législation qui travaille dans l’intérêt des deux? Ne fait-il pas, du sujet féodal, le citoyen moderne? Ne donne-t-il pas à chaque particulier le droit de se gouverner lui-même et de déterminer son sort dans l’État? L’électeur n’est-il pas, le jour où il nomme son député, un souverain réel qui exerce, quoique indirectement, les anciens droits royaux de renverser et de faire des ministres, de destituer et de nommer des employés, de faire des lois, d’établir des impôts, d’imprimer sa direction à la politique extérieure?
Le bulletin de vote n’est-il pas, en un mot, l’arme toute puissante à l’aide de laquelle notre pauvre Jean peut détourner de lui la pression de l’arrogance bureaucratique déjà dénoncée par Shakespeare et combattre avec succès toutes les institutions qui l’enserrent? Sans doute. Le parlementarisme a tous ces effets – mais, malheureusement, seulement en théorie. En pratique, c’est un énorme mensonge, comme toutes les autres formes de notre vie politique et sociale. Je dois faire remarquer ici que les mensonges qui de toutes parts nous sautent aux yeux sont de deux espèces différentes. Les uns portent le masque du passé, les autres celui de l’avenir; les uns sont des formes qui n’ont plus de raison d’être; les autres des formes qui n’en ont pas encore. La religion et la royauté sont des mensonges, parce que nous laissons subsister leurs dehors, quoique nous soyons pénétrés de l’absurdité de la base sur laquelle elles reposent. Le parlementarisme, au contraire, bien que découlant logiquement de notre conception du monde, est un mensonge, parce que, jusqu’à présent, il n’existe que comme forme extérieure, et n’a pas apporté le moindre changement à l’organisation intérieure de l’État. Dans le premier cas, c’est du vin nouveau dans de vieilles outres; dans le second cas, ce sont de vieux déchets dans des récipients neufs.

Le parlementarisme prétend être la sanction du principe fondamental de la souveraineté populaire. D’après la théorie, le peuple tout entier, dans des assemblées plénières, devrait faire ses lois et nommer ses employés, par conséquent exprimer directement sa volonté et la transformer aussitôt en actes, sans l’exposer à la déperdition de forces et aux déformations qui sont une conséquence nécessaire des transmissions réitérées. Mais comme le développement historique tend à grouper les individus en masses politiques toujours plus grandes, à fondre des communautés entières de langues, peut-être même bientôt des races entières, en nations uniques, et à étendre à l’infini les frontières des États, l’exercice direct du self-government par la totalité du peuple est devenu dès maintenant, dans l’immense majorité des pays, une impossibilité matérielle ; là où il n’existe pas encore, il aura sans aucun doute le même sort dans un avenir prochain. Le peuple doit donc déléguer sa souveraineté à un petit nombre d’élus, et s’en rapporter à eux pour l’exercice de ses propres droits. Les élus ne peuvent pas encore gouverner directement eux-mêmes, mais ils délèguent à leur tour leurs pouvoirs à un nombre bien plus petit encore d’hommes de confiance —les ministres — qui, enfin, préparent et appliquent les lois, établissent et lèvent les impôts, nomment les employés et décident de la guerre et de la paix. Pour qu’au milieu de tous ces arrangements le peuple continue à rester souverain, pour qu’en dépit de la double délégation ce soit toujours sa volonté et nulle autre qui règle ses destinées, il faudrait que différentes hypothèses devinssent une réalité. Les hommes de confiance du peuple devraient se dépouiller de leur personnalité. Sur les bancs du parlement, ce ne sont pas des hommes qui devraient prendre place, mais des mandats parlant et votant. La volonté du peuple, en passant par ses représentants, ne devrait subir en eux aucune coloration ni aucune réfraction, aucune influence individuelle. Les ministres, de leur côté, devraient être en quelque sorte des canaux de réception, des conducteurs également impersonnels, également mécaniques des opinions et de la volonté de la majorité du parlement. Toute inobservation du mandat que les ministres ont reçu des députés, et ceux-ci du peuple, devrait avoir comme conséquence immédiate, pour ceux-là la chute, pour ceux-ci la déchéance. Mais il faudrait avant tout que ce mandat fût clair et net. Les électeurs auraient toujours à s’entendre sur les travaux législatifs et administratifs qui leur semblent nécessaires dans l’intérêt de l’État, et à exiger de leurs représentants l’exécution de ces travaux, en s’alléchant sévèrement aux prescriptions données. Il faudrait ne choisir pour représentants que des hommes dont les électeurs connaissent le caractère et le mérite intellectuel, qu’ils savent capables de comprendre et d’exécuter le programme fixé par les électeurs, des hommes qui ne s’écarteront pas de la ligne qui leur est tracée, et qui sont assez dépourvus d’égoïsme pour sacrifier au bien commun leur temps, leur travail et notamment leur propre intérêt, chaque fois que cet intérêt se trouve en opposition avec le bien commun. Ce serait là le parlementarisme idéal ; de cette façon, la législation émanerait vraiment du peuple, l’administration émanerait du parlement; le centre de gravité de l’édifice public se trouverait dans les assemblées électorales, et chaque citoyen participerait d’une façon visible et palpable à la gestion des affaires.
Passons maintenant de la théorie à la pratique. Quelle désillusion ! Le parlementarisme, tel qu’il fonctionne dans les pays classiques, l’Angleterre et la Belgique, ne répond pas à une seule de nos hypothèses. L’élection n’exprime en aucune manière la volonté des citoyens. Les députés agissent en toute circonstance suivant leur bon plaisir individuel et se sentent liés uniquement par la crainte de rivaux, et non par les égards dus à leurs électeurs. Les ministres ne gouvernent pas seulement le pays, mais aussi le parlement; au lieu qu’on leur prescrive la direction, ils la prescrivent au parlement et à la nation. Ils arrivent au gouvernement et le quittent non parce que la nation le veut ainsi, mais parce qu’une puissante volonté individuelle les mène. Ils jouent comme bon leur semble avec les forces et les ressources de la nation, distribuent faveurs et présents, laissent de nombreux parasites s’engraisser aux frais du peuple. Ils n’ont jamais à craindre un mot de blâme, pourvu qu’ils distribuent à la majorité du parlement quelques reliefs de la table splendide que l’État leur dresse. En pratique, les ministres sont aussi irresponsables que les députés ; les nombreux abus, les injustices et les actes arbitraires qu’ils commettent journellement, restent impunis. Si une fois en un siècle un ministre vient à être poursuivi, soit que sa conduite ait été réellement infâme, soit qu’il ait excité contre lui une haine passionnée, cela se termine toujours par une mise en scène judiciaire bruyante et pompeuse et par un châtiment d’une nullité ridicule. Le parlement est une institution destinée à satisfaire la vanité et l’ambition des députés et à servir leurs intérêts personnels. Les peuples sont accoutumés depuis des milliers d’années à être dirigés par une volonté souveraine et à avoir au-dessus d’eux une aristocratie privilégiée à laquelle ils rendent des honneurs et abandonnent toutes les richesses de l’État. De grands esprits ont donné aux peuples, dans le parlementarisme, une forme gouvernementale qui leur permet de substituer leur volonté à la volonté souveraine et d’enlever à l’aristocratie la disposition de la fortune de l’État. Qu’ont fait les peuples? Ils se sont hâtés d’accommoder le parlementarisme à leurs anciennes habitudes, de sorte qu’après comme avant une volonté individuelle les gouverne et une classe privilégiée les exploite ; seulement, cette volonté individuelle ne se nomme plus roi, mais chef de parti, et cette classe privilégiée ne se nomme plus, nécessairement, aristocratie de naissance, mais majorité dominante de la Chambre. L’ancienne situation du citoyen ordinaire vis-à-vis de l’État n’a pas été modifiée par le parlementarisme ; mon Jean, auquel je reviens toujours, a partout à payer des impôts qu’il n’établit pas et dont il ne détermine pas l’emploi, à obéir à des lois qu’il ne se donne pas et dont il ne voit pas l’utilité, à tirer son chapeau devant des employés qu’une volonté étrangère lui impose. Jean se nomme John Bull en Angleterre et Ivan en Russie.
Le parlementarisme offre un avantage : il permet aux ambitieux de monter sur les épaules de leurs concitoyens. Je vais montrer que c’est vraiment un avantage.
[…]
Nul mot n’apparaît aussi fréquemment dans cet ordre de choses que le mot « Moi ». —Moi et rien que Moi. C’est précisément parce que le parlementarisme est le triomphe, l’apothéose de l’égoïsme. En théorie, il doit être la solidarité organisée, en fait il est l’égoïsme érigé en système. D’après la fiction, le député dépouille son individualité pour se fondre avec un être collectif impersonnel par qui les électeurs pensent et parlent, veulent et agissent; dans la réalité, les électeurs se dépouillent, par l’acte électoral, de tous leurs droits en faveur du député, et celui-ci acquiert toute la puissance que ceux-là perdent. Dans son programme, dans les discours où il brigue les suffrages des électeurs, le député entre naturellement dans cette fiction ; là, il ne s’agit jamais que de l’intérêt public, là, il ne veut travailler que pour le bien général, il veut s’oublier lui-même au profit du peuple. Mais ce sont des formules que même l’électeur le plus naïf, le plus complaisant, ne prend plus guère à la lettre. Qu’est-ce, pour le député, que l’intérêt général et le bien public? Pure affaire de comédie : le député veut parvenir, et l’électeur doit être son marche-pied.
Travailler pour le peuple? Allons donc! C’est le peuple qui doit travailler pour lui. On a nommé les électeurs un bétail à voter : cette métaphore est d’une rare justesse. Le parlementarisme crée des conditions tout à fait analogues à celles du temps patriarcat. Les députés occupent la situation des patriarches; leur puissance repose sur leur richesse, qui consiste dans la possession de grands troupeaux. Seulement, ces troupeaux ne se composent plus aujourd’hui de bêtes réelles, mais de ce bétail métaphorique qui, le jour du vote, dépose son bulletin dans l’urne. Rabagas devait être une caricature et une satire; il me semble plutôt un type réel. Il n’y a rien d’étonnant ni de risible à ce que Rabagas, le grand révolutionnaire, une fois arrivé au pouvoir avec le secours du peuple, emploie contre le peuple absolument les mêmes moyens de gouvernement et d’oppression dont, dans ses discours incendiaires, il a fait un crime aux ministres qui l’ont précédé. Ce changement me parait naturel et logique. Le politique n’a pas d’autre but, dans ses actions, que la satisfaction de son égoïsme. Pour y arriver, il doit obtenir l’appui de la masse. Or, on n’obtient cet appui qu’à force de promesses et de traditionnels mots à effet que l’on débite aussi machinalement qu’un mendiant son Pater noster. Le politique se soumet à cet usage sans hésiter. Quand il a été nommé par ses électeurs, son amour-propre est satisfait, et la masse disparaît complètement à ses yeux pour ne surgir de nouveau que si elle le menace de lui ôter sa puissance. Alors, il fera ce qu’il faudra pour conserver celle-ci, comme il l’a fait pour l’acquérir. Selon les exigences de la situation, il dévidera de nouveau le chapelet des promesses et des phrases à effet, ou il menacera du poing ceux qui murmurent. C’est cet enchaînement de prémisses et de conséquences logiques que l’on nomme : parlementarisme.
* * * * *
Sources : Max Nordau, Les mensonges conventionnels de notre civilisation, traduit par Auguste Dietrich, Paris, 1897, pp. 161-176
* * * * *
Illustration : http://images-gededah.in/
* * * * *



