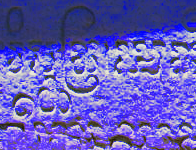
« La plupart du temps, à la Cour des rois, la méchanceté des détracteurs a plus de puissance que le crédit des gens de bien. Celui qui calomnie n’est pas seulement coupable, mais encore celui qui prête l’oreille à la calomnie. »
Henri Cornélis Agrippa
Pour clore cette série d’articles sur Agrippa, nous publions quelques-unes de ses correspondances qui illustrent sa vie, son combat, ses déboires et ses détresses. Agrippa ne correspondait pas seulement avec des hommes de lettres et de sciences de son époque tels qu’Érasme ou Jacques Lefebvre d’Étaples (1450?-1536) [1], mais aussi avec des hommes d’Église dont certains étaient ses amis ou des protecteurs. Ses liens avec des hommes de pouvoir sont dignes d’intérêt pour ceux qui s’intéressent à la vie des princes et des monarques : on ne sera pas étonné de le voir coincé par l’homme le plus puissant de l’époque, l’empereur Charles-Quint.
Au-delà de l’aspect anecdotique, sa correspondance nous renseigne aussi sur le climat intellectuel de l’époque, elle nous apprend par exemple :
- comment la magie qui était une discipline respectable pendant de longues périodes, s’est vue déclassée au rang de charlatanisme par la suite ; l’Église n’est pas du tout innocente sur cette question : même à l’époque d’Agrippa, des procès de sorcellerie faisaient encore dresser les cheveux, d’ailleurs Agrippa a courageusement défendu une vieille paysanne, dans les environs de Metz, accusée de sorcellerie. Quoi qu’il en fût la magie n’était pas tout à fait morte puisque le meilleur cabaliste du XIXè siècle en France, le prêtre défroqué mais qui reste fidèle à l’Église Éliphas Levi en parle abondamment dans son ouvrage majeur que nous avons évoqué il y a quelque temps.
- Les débats théologiques qui secouaient la société opposant des hommes illustres de science et de lettres tels que Jacques Lefebvre d’Étaples et Agrippa aux autorités cléricales. Ils ont défendu ce qui leur semblait la vérité historique contre les dogmatiques sur diverses questions touchant à Anne, Marie et Madeleine, le trio intouchable en son statut.
- Qu’Agrippa a besoin d’un appui de poids et espère le trouver en la personne du cardinal Laurent Campegio, dans son combat contre ses ennemis qui l’accusent d’hérésie et d’impiété. Les termes avec lesquels il implore le cardinal de lui accorder sa protection, ou pour décrire la situation dans laquelle il se trouve, montrent à quel point cette affaire est une question de vie et de mort pour lui, mais pas au sens matériel ou physique puisqu’il s’agit d’honneur, de réputation d’un homme. En pressant son protecteur de le soutenir il lui glisse aussi les bonnes raisons de le faire : « Il ne peut vous déplaire de lutter contre de perfides faussaires, contre des sycophantes impies et criminels, pour prendre la défense de la Piété et de la Bonne Foi. »
Cette correspondance est extraite de l’ouvrage déjà cité de Joseph Orsier (1843-1923) , Henri Cornélis Agrippa d’après sa correspondance (1486-1535), Paris, 1911, 148 p.
À l’honorable père Jean Tritheim, abbé de Saint-Jacques, dans le faubourg de Würzbourg, Henry Cornélis Agrippa souhaite bonheur et salut.
En 1510.
Quand je passai dernièrement quelque temps auprès de vous dans votre cloître à Würzbourg, honorable père, et que nous eûmes longtemps parlé de chimie, de magie, de cabale, et d’autres sciences et arts occultes, il s’éleva, entre autres, l’importante question de savoir pourquoi la magie, qui avait d’abord, selon le jugement unanime de tous les anciens philosophes, pris le premier rang et qui était tenue dans la plus haute considération par les sages et les prêtres de l’antiquité, devint plus tard, pour les saints pères et, depuis l’existence de l’Église catholique, aussi détestée que soupçonnée, repoussée par les théologiens, condamnée par les Saints Conciles et fut enfin partout bannie par des lois spéciales. Après mûre réflexion, je crois en avoir trouvé la raison en ce que, à mesure que les temps et les hommes devinrent plus mauvais, il se glissa beaucoup de pseudo-philosophes et de prétendus magiciens qui empruntèrent à de fausses sectes et partis religieux des cérémonies des plus sombres, superstitieuses et répréhensibles, et firent même de la religion orthodoxe un usage désastreux contre l’ordre naturel et pour la perte des hommes. Ce sont eux aussi qui ont publié ces malheureux livres que l’on rencontre ça et là, et auxquels ils ont donné le nom, si honoré autrement, de Magie. Comme ils essayaient, par ce titre si honorable de mettre leurs jongleries maudites en circulation, ils firent tant que le nom de Magie, autrefois tenu en si haute estime, est maintenant honni par tous les bons et honnêtes gens et que c’est à présent un grand péché d’oser, soit en paroles, soit en écrit, se donner pour magicien, moins d’être une vieille femme de la campagne, ayant la réputation d’être versée dans ces sortes de choses et qui veut faire croire au vulgaire (comme dit Apulée) qu’elle peut attirer le ciel, suspendre la terre, tarir les sources, taire disparaître les montagnes, faire revenir les morts, affaiblir les dieux, éteindre les étoiles et même éclairer le Tartare; ou, comme chante Virgile « Elle promet, par des chants magiques, de délivrer les cœurs qu’elle veut, d’en charger d’autres des chaînes de l’amour, d’arrêter les fleuves dans leur cours, de détourner les étoiles. » Elle conjure aussi les mânes de la nuit. On voit la terre mugir sous ses pieds et des ombres se promener sur les montagnes.
Des choses telles qu’en racontent, par exemple, Lucain de cette enchanteresse thessalienne, Homère, de la toute-puissance de Circé, ne sont en majeure partie que mensonges, superstitions, inventions pernicieuses, qui, quoiqu’elles ne puissent être comprises dans ce qui appartient à un art permis, prennent cependant comme enseigne le titre honorable de magie. En voyant de pareils faits, je me trouve à la fois étonné et mécontent que personne n’ait encore entrepris de protéger une science si élevée et si sainte contre ces coupables profanations, ou au moins ne l’ait exposée dans toute sa pureté car tous les moins anciens, autant que je sache, tels que Roger Bacon [2] et Robert, Pierre d’Abano, Albert le Grand [3], Arnold de Villanova, Anselme de Parme, l’Espagnol Picatius, le Florentin Sicchus, Asculus et bien d’autres auteurs, mais moins connus, qui promettent, il est vrai, d’enseigner la magie, ne nous offrent cependant que quelques chimères sans base raisonnable ou bien des superstitions indignes de tous les honnêtes gens. Cela me fit penser à moi, qui, dès ma première jeunesse, avais recherché avec attention et sans crainte tout ce qui existe de merveilleux et de secret, que ce ne serait pas une entreprise sans mérite si je rétablissais, et si j’entreprenais de la protéger contre ses détracteurs, la vraie magie, cette première science de tous les sages, après t’avoir, au préalable, épurée de ces falsifications malhonnêtes, et en avoir soigneusement développé les principes.
Quoique cette pensée me tourmentât depuis longtemps, je n’osais pas encore jusqu’ici la mettre à exécution. Cependant, depuis notre entretien à Würzbourg sur de semblables sujets, votre parfaite expérience et votre savoir ainsi que votre pressant encouragement m’ont communiqué une force nouvelle. Je viens donc de composer, d’après les philosophes les plus éprouvés, tout en élaguant ce qui, sous le nom de traditions magiques, était faux et magique, III livres sur la magie, sous un volume aussi succinct que possible et je leur ai donné le nom moins offensif de Philosophie occulte. Comme Votre Honneur a les connaissances les plus étendues dans ces sortes de choses, je dépose ce travail en vos mains pour que vous en preniez connaissance et le jugiez, afin que si, en quelque endroit, j’ai péché contre la nature, contre Dieu ou contre la religion, vous condamniez l’erreur que, d’un autre côté, cependant, vous vouliez bien aussi protéger la vérité, si la méchanceté, avec laquelle on défigure cette science, vous semble condamnable. Je vous prie surtout de vouloir bien en agir avec ce travail comme avec la magie elle-même, de manière que rien de ce qui pourrait être utile ne demeure caché, et que rien de ce qui pourrait nuire ne trouve approbation, afin qu’après avoir été approuvé par vous il soit digne un jour de paraître en public et qu’il n’ait rien à craindre du jugement de la postérité.
Soyez heureux, et veuillez prêter à notre entreprise toute votre indulgence.
Jean Tritheim [4], abbé de Saint-Jacques, à Würzbourg, offre ses compliments amicaux à Henry Cornélis Agrippa de Nettesheim.
8 avril 1510.
Aucune langue mortelle ne pourrait jamais exprimer ni aucune plume écrire avec quel plaisir, très honoré Agrippa, j’ai reçu votre travail sur la philosophie occulte que vous m’avez envoyé par porteur, pour correction.
Je considère votre savoir avec l’admiration la plus vive, car, vous plongeant tout jeune encore dans des secrets si profonds, inconnus à beaucoup d’hommes les plus savants, vous avez su les représenter non seulement d’une manière excellente et vraie, mais encore dans un style brillant.
Recevez donc mes remerciements et, avant tout pour votre confiance en moi, et je chercherai encore à vous les offrir plus publiquement. Votre travail, que le plus grand des érudits ne saurait assez louer, reçoit mon approbation: je vous en avise et vous prie instamment de continuer à poursuivre dans cette voie ne laissez pas sommeiller une si remarquable puissance intellectuelle, mais, au contraire, exercez-la sans cesse dans sa plénitude et faites- en profiter ceux qui ignorent cette lumière de la sagesse, dont vous êtes éclairé à un si haut degré, par la volonté de Dieu.
Ne vous laissez pas détourner de votre entreprise par ce que des gens sans valeur peuvent avoir à dire, et auxquels on peut appliquer le proverbe qui dit ( Le bœuf indolent demeure plus obstinément immobile. » Au jugement des philosophes, personne ne peut être vraiment savant, qui renonce aux éléments d’une seule science. Dieu vous a donné des dons intellectuels étendus; vous n’imiterez pas le bœuf, mais plutôt l’oiseau; vous ne croirez pas devoir vous arrêter aux détails, mais efforcez-vous plutôt d’embrasser courageusement les principes généraux. En effet, chacun est considéré d’autant plus instruit que plus de choses lui sont familières. Quoique votre esprit soit apte à tout recevoir, vous ne devez pas vous occuper de peu, ni du plus bas, mais de beaucoup et des idées les plus élevées. Je vous donnerai encore un conseil : laissez au commun les choses communes, et ne partagez qu’avec les hommes de marque et des amis éprouvés les choses supérieures et les secrets. « Du foin au bœuf, au perroquet seulement, du sucre! » Sondez les âmes, afin qu’il ne vous arrive pas, comme il arrive à tant d’autres, de vous trouver sous les pieds du bœuf. Vivez heureux, mon ami, et, s’il est en mon pouvoir de vous rendre service, ordonnez et j’agirai sans retard. Mais, afin que notre amitié s’accroisse de jour en jour, écrivez-moi souvent; envoyez- moi également quelque chose de vos savants travaux, je vous en prie instamment.
Encore une fois, vivez heureux ! Dans notre cloître, à Würzburg le 8 avril 1510.
Un ami à Agrippa.
Entre les années 1517 à 1519, de Genève.
Il y a quatre jours j’ai reçu de vous deux lettres à la fois, excellent Cornélis, et, bien que le sujet en soit différent, elles sont remarquables également toutes deux par leur élégance et l’éclat du style. Comme elles me parlaient de l’impiété de ce personnage et de son opiniâtre ingratitude, je n’ai pu, par Hercule, ne pas être violemment affligé, m’indigner contre ces coups cruels de la Fortune qui n’hésite pas à sévir durement contre un homme d’une si grande vertu. Un homme magnanime comme vous ne doit pas céder, cher Henri. Il ne faut point baisser pavillon devant cette maîtresse infidèle sans contredit, les traits dont elle vous accable répandront sur votre rare mérite un éclat aussi merveilleux que durable. C’est un sort qui nous est commun à tous, par Pollux l’un est en butte aux outrages, aux affronts, l’autre est exposé à la mort, celui-là à se prémunir contre l’affreux aiguillon de l’ingratitude. Il arrive même trop souvent, hélas, que les justes, les innocents, sont plus sujets que les autres aux injures variées de la foule des hommes impies. Ne devons-nous pas supporter tout cela avec résignation? Devons-nous céder un pouce devant les injustices, l’ingratitude, devant les menaces et les hostilités de la Fortune ? Est-ce à vous surtout de le faire, à vous, homme fort et modeste entre tous qui n’êtes déjà que trop familiarisé avec les vicissitudes de la destinée. Oui, je m’en doute, vous avez dû déjà en souffrir de plus cruelles; vous avez dû supporter les assauts violents et aveugles d’une Fortune plus cruelle encore et plus inique. Votre âme a dû s’y endurcir, s’entourer d’une cuirasse qui ne saurait céder à ses coups. Vous devez donc mépriser l’adversité. Vous devez donc en accepter plus patiemment les atteintes qui sont relativement légères, à moins que vous ne sachiez vous maîtriser. Voudriez-vous lutter follement contre l’inévitable (puisque vous déplorez si vivement vos tribulations), contre cet inévitable que Plotin [5] a défini pouvoir inéluctable des lois divines ? N’est-ce point par la volonté de Dieu que chaque jour nous vivons en de semblables angoisses ? Comme le dit encore cet auteur, la divinité agit toujours dans les événements, comme le veut sa nature. Or, sa nature étant divine, elle agit seulement d’après cette essence divine. Ces vicissitudes, ces agitations qui bouleversent l’océan de la vie, ces alternatives d’heur et de malheur qui nous arrivent, tout cela ne vient que selon la permission de la Justice Suprême. Pour ces motifs, nous devons regarder comme privé du bon sens le plus vulgaire celui qui voudrait lutter contre cette nécessité divine, se soustraire criminellement à ce joug qui, plus tard, nous sera compté pour notre bonheur éternel, dans la patrie céleste. Que dis-je, insensé que je suis ? Où me laissais-je emporter ? Il me semble que je veux apporter des corneilles à Athènes [6].
Pour en revenir mon sujet, vous n’avez pas agi avec assez de réflexion; c’est du moins mon avis, quand vous avez refusé le salaire que vous offrait le plus ingrat des hommes, surtout en ce moment que vos affaires sont si embarrassées. Elle me paraît absurde, par ma foi, cette détermination de se venger qui ne profite qu’au coupable et cause un dommage à l’homme dévoué qui a rendu de bons offices. Vous agirez donc plus sagement si, oubliant votre indignation, vous acceptez cet argent, tout modeste soit-il, pourvu toutefois que notre ingrat personnage veuille encore vous l’offrir. Cet argent vous est d’abord nécessaire dans les circonstances fâcheuses où vous vous trouvez maintenant en second lieu, il sera beau et louable, auprès du monde, de ne pas paraître aveuglé outre mesure par l’amour de l’argent. On vous regardera comme modéré dans vos désirs et, par cette vertu de bon aloi qui vous est naturelle, vous gagnerez une bonne renommée. Quant à la promesse que vous me faites de venir bientôt ici, j’en ai vraiment éprouvé une joie si grande que j’ai cru un moment qu’on m’avait enlevé dix ans de ma vie, déjà si avancée, de dessus les épaules. Rien, par Hercule, de si heureux, de si honorable, de si agréable ne pouvait m’arriver durant tout le cours de mon existence que de me mettre en relation directe, de me soumettre aux critiques, aux observations d’un excellent homme et, en même temps, d’une science si consommée. S’il est donc certain que vous viendrez ici, ô désiré Cornélis, s’il vous plaît de connaître le site de cette ville, les mœurs de ce peuple dont vous avez déjà assurément des notions, si vous pensez que le séjour dans notre pays pourra vous être à honneur et profit, persistez, je vous en prie, dans cette résolution.
En conséquence, pour que je puisse pourvoir à tout et principalement aux arrangements domestiques nécessités par votre arrivée, écrivez-moi le plus tôt possible le jour et l’heure fixés, quand toutefois vous serez bien décidé. Puisque vous désirez aussi savoir par quelle route, par quels moyens, avec quelle aide, vous pourrez le faire, je vous le dirai en dernier lieu, puisque vous m’en manifestez le désir, autant que, dans la circonstance présente, il me sera possible de le faire. Je devine, en outre, combien le peu d’espoir que vous avez dans l’utilité de votre voyage auprès de nous, vous le placez entièrement en notre ami dévoué Eustache Chapuys [7]. Mais vous ignorez sans doute, cher Henri, à quel point cet homme si sûr, le meilleur de vos amis, voit avec peine que vous ne lui ayez absolument rien écrit. Aussi, écrivez-lui donc, écrivez-lui le plus tôt possible. Répondez à un ami si digne et si cher, qui vous est dévoué entre tous et qui vous aime tant. Adieu, Maître vertueux, ma lumière unique. Pardonnez à une lettre un peu verbeuse, et à d’aussi grandes inepties que celles que je vous débite.
Genève, 16 novembre.
Jacques Lefebvre d’Etaples [8] à Henri Cornélis Agrippa, salut.
Paris, 20 mai 1519.
Très honorable maître et docteur, le Révérend Père Claude Dieudonné [9] m’a remis votre lettre. Je l’ai lue avec le plus grand plaisir.

Jacques Lefebvre d’Étaples
Quel est l’homme, en effet, qui ne lirait pas avec délices ce qui part de la sincérité d’âme et d’une bienveillance dont il ne peut douter ? Je vous en supplie, ne vous alarmez pas de ce que plusieurs personnes se sont déclarées les adversaires de mes écrits tant au sujet d’Anne que de Madeleine. J’espère qu’un jour se fera la vérité sur ces matières. Du reste, je ne fais que discuter et n’avance rien de hasardé en conclusions. Je vous en supplie donc, qu’à ce sujet personne ne perde votre bienveillance. La fausseté se découvrira et succombera d’elle-même, bien que personne ne l’attaque. Je vous envoie la défense de mon argumentation, défense élaborée par un docteur en Théologie de notre Sorbonne. Elle n’est pas sans mérite. Je vous envoie encore l’apologie de Sainte Anne qu’on m’a envoyée d’Allemagne ex dono auctoris. J’en ai lu une autre du Vice-Général des frères de Saint-François, mais il la conserve chez lui. Il donne un seul mari à Anne, mais trois filles. Après l’avoir examinée, j’ai jugé qu’elle ne concorde pas avec notre manière de voir, qu’elle ne vise pas notre dissertation; cependant, si vous tenez beaucoup à la connaître, j’espère pouvoir l’obtenir. A votre première lettre, édifiez-moi là-dessus. J’ai préparé mon second travail sur Madeleine. Attendez-le par le plus prochain courrier allant de votre côté.
Adieu.
Henri Cornélis Agrippa, à Jacques Lefebvre d’Etaples.
De Metz, juin 1519.
Attendu que jusqu’ici, illustre Lefebvre, nous avons été toujours séparés par une telle distance qu’aucune communication intime, aussi désirée qu’elle fût, n’était possible entre nous, que bien des difficultés s’y opposaient aussi, outre l’éloignement, j’ai retenu la plume jusqu’au moment où je devais devenir votre voisin, bien que, plusieurs fois, l’occasion et la facilité de vous écrire se soient présentées à moi. Enfin, une occasion nouvelle se présentant, ayant pu m’assurer de la largeur de vos vues et me confiant à votre caractère des plus honorables, j’ai écrit récemment à votre Humanité, par l’entremise du Père célestin Claude Dieudonné, une lettre que vous devez avoir probablement reçue.
Ce Bon Père a dû vous présenter aussi certaines propositions sur l’unique mariage de sainte Anne, sur son unique et simple accouchement. J’ai rédigé ces propositions d’après ce que vous avez écrit dans votre opuscule à la fois savant et élégant par son style, opuscule intitulé Des trois et de la seule Madeleine [10]. Je me suis borné, selon mon habitude, à les extraire de votre long et remarquable travail, à les condenser le plus possible, mais non pas pour m’acquérir de la gloire aux dépens de votre mérite, veuillez m’en croire. Il en est peut-être qui agiraient ainsi pour passer comme savants auprès de ceux qui ne connaissent pas votre nom. J’ai toujours évité ce procédé comme un véritable sacrilège. Aussi, après avoir énoncé ces propositions, après les avoir achevées, j’ai fait mention deux fois pour chacune d’elles de votre nom d’auteur, et j’ai naturellement cité votre ouvrage. Voici le motif qui m’a poussé à écrire ces Propositions c’était, croyez-le bien, de profiter de l’occasion pour m’opposer à vos calomniateurs.
Assurément, tels qu’ils sont, ce sont des hommes ennemis de tous les gens instruits. Parmi eux, il y en a surtout trois ici à Metz qui vous sont tout à fait hostiles : le premier est un certain frère Dominique Dauphin, de la Congrégation des Frères Franciscains de l’Observance, l’autre le frère Nicolas Orici, de la Congrégation des Frères Mineurs; le troisième enfin, le frère Nicolas Salini, Prieur de la Confrérie des Prédicateurs. C’est un docteur de la Faculté de Théologie de Paris. Or, ce fameux Docteur, à ce que j’apprends, bien qu’ayant caché d’abord son identité, a secoué après de longs jours la contrainte que lui imposait la modestie et s’est décidé à écrire contre nos Propositions. Il a fait plus, bien plus encore il a écrit contre votre livre une tragédie inepte, mais digne de lui, dont les conclusions, ce sont les confusions que je devrais dire, m’ont été présentées, il y a trois jours à peine, avec accompagnement d’éloges pompeux pour cette élucubration, mais avant la victoire assurément. Je vous en adresse une copie en même temps que mes Propositions vous y verrez que je suis le fidèle défenseur de votre honneur et aussi combien sont risibles leurs plates sottises, en quel estime vous devez les tenir ; vous y apprécierez enfin ce que sont les apôtres de cette cité, ceux qui prêchent l’Evangile. Ce n’est point pour que vous leur répondiez ; je ne voudrais pas que vous prissiez la peine de prendre la plume contre le dernier ; surtout il serait capable d’aller s’imaginer qu’il est digne d’entrer en lice contre vous, du moment que vous l’acceptez comme adversaire.
Quant à moi, à qui la médiocrité seule suffit, et encore ces choses-là sont-elles médiocres, je n’en sais trop rien, je vous conseille de laisser le combat, de le refuser. J’ai la confiance que je suis moi-même de force à combattre sans défaillance avec grand succès et à défendre votre renom, votre bonheur, votre honneur et votre gloire contre cette espèce, cette engeance de Cerbères aboyeurs. Du reste, si vous avez auprès de vous à Paris cet ami dévoué qui se nomme le Père Claude [11], que j’ai nommé plus haut, dites-lui en mon nom une foule de choses agréables et communiquez-lui ces écrits. Je sais en effet qu’il vous aime et vous vénère au-delà de toute expression.
Adieu, homme heureux, le plus bel ornement de la société des gens réellement instruits.
De Metz, le 16 avant les calendes de juin 1519.
Claude Dieudonné [12] à Agrippa.
Annecy, 26 juin 1521.
Savant docteur, la nouvelle, quoique tardive, de votre séjour dans Genève m’a comblé de joie. Elle me donne, en effet, l’espérance de revoir un ami tant regretté et de pouvoir jouir encore de ses doctes et sages entretiens. Oui, je l’affirme avec force, jamais amitié ne m’a été plus douce que la vôtre, illustre Agrippa. Que ne puis-je passer toute ma vie avec vous! La chose m’est impossible; mais il me reste du moins le plaisir si grand encore de vous entretenir par correspondance. Comment allez-vous? Quelles sont vos occupations présentes? Qu’avez-vous fait ces derniers temps? Avez-vous reçu la lettre que je vous ai écrite peu après notre séparation ? Dites-moi si la seconde édition du Nouveau Testament d’Érasme est certainement imprimée. J’ai écrit aux libraires de Lyon de me l’envoyer, à n’importe quel prix. Où en est Luther ? Sa traduction des Psaumes est-elle achevée? Je le désire ardemment
Adieu, très docte ami. Votre serviteur
Agrippa à Charles-Quint.
Bruxelles, 1531.
J’ai été, redoutable Empereur, réduit à une telle infortune pour rester à votre service qu’à part la perte de la vie vous ne pourriez m’en souhaiter de plus grande. Bien que, dernièrement encore, poussé par je ne sais quelle dureté d’âme, vous ayez détourné les yeux de mes supplications, je veux encore une fois, imitant en cela l’exemple de la Nature à l’égard des moribonds, faire auprès de vous un dernier effort. Je reviens donc à vous comme suppliant, ne vous demandant qu’une seule chose. S’il ne m’est permis d’obtenir de votre bonté ce qui est dû à mon mérite, la récompense et le salaire de mes fonctions, que j’obtienne du moins de votre indignation, si toutefois vous êtes indigné contre moi, un congé en forme. Puisqu’il ne m’est pas permis d’espérer, qu’il me soit du moins permis par vous de désespérer. Délivrez- moi du serment de fidélité que j’ai prêté à Votre Majesté reniez-moi, si vous le voulez, mais permettez que je me retire libre. Ne vous irritez donc pas si je vous parle ainsi, dans l’accès de de mon désespoir j’y suis forcé, vous le savez : nécessité n’a pas de loi.

Couronnement de Charles-Quint
Agrippa à un personnage ecclésiastique.
1531
Votre Excellence, Rév. Père, m’a requis de lui dire ce que je pense de la comète qui apparut hier soir. Vous me demandez là-dessus quelques mots seulement. Je n’ignore pas qu’on pourrait m’accuser de témérité et d’arrogance si j’écrivais à une personne aussi éminente que la vôtre des explications hasardées et sans avoir sur ce point cherché la vérité. Mais je pense aussi que ce serait une grande faute si je ne répondais pas à temps à la question que me pose Votre Seigneurie, envers laquelle je suis si redevable.
J’ai, en conséquence, préféré encourir l’accusation d’ignorance ou d’étourderie, que celle d’ingratitude, sachant bien, au courant depuis longtemps des Saintes-Écritures, que l’obéissance vaut mieux que n’importe quel sacrifice. Aussi, malheureusement dégagé que je suis de mes travaux ordinaires, je vais essayer de formuler à ce sujet ce qui ne reste chez moi qu’à l’état de vague souvenir. Ceux qui ont écrit sur l’Astrologie judiciaire comptent, je crois, neuf ou dix sortes de comètes-étoiles. Du reste, je ne prétends pas qu’il n’y en ait pas d’autres, que la postérité n’en puisse trouver d’autres catégories ; je sais même qu’autrefois trente-deux genres de comètes ont été dépeints par les Stoïciens. De là les Comètes Poyniennes [13] Acontiennes [14], Piphiennes [15], Phitètes [16], Césariennes [17] , Lampades [18], Hippées [19], et plusieurs autres espèces dénommées par les Grecs. Mais je suivrai l’ordre généralement adopté par les Astrologues, qui nomment une Comète Saturnienne, parce qu’elle est de la couleur pâle du plomb; elle n’a pas la queue si longue que les autres. Il en est deux qu’ils nomment Joviennes : dont l’une est nommée Argentée à cause de son éclat d’argent et de l’éclat fulgurant de sa queue ; l’autre, Rose. Elle est un peu plus grande et de la forme d’une face humaine: sa queue est longue, sa couleur tourne un peu sur le jaune comme un alliage d’or et d’argent, elle est très brillante. Ils en donnent quatre à Mars l’une appelée Pertica, qui est brillante, incandescente même et dont la queue est formée d’un seul rayon et ressemble à une longue lance étendue, l’autre se nomme Vera, qui ne diffère pas beaucoup de la première, à cela près qu’elle a une queue ondulée, en quelque sorte vibrante, la troisième se nomme Tenacula, de sa queue fourchue, – la quatrième se nomme Églantine mûre, parce que, comme le fruit de l’Églantier en maturité, elle est d’une couleur rutilante, ignée; sa queue forme un grand nombre de rayons. Il en est une ensuite qui est consacrée à Vénus ; on l’appelle le Soldat : elle est la plus redoutable de toutes, son volume est considérable, sa queue très longue elle est étincelante et brillante. Une autre est attribuée à Mercure ; appelée Seigneur d’Astorie, elle est d’une couleur de citron et radiée, et son corps forme plusieurs rayons dirigés en tous sens, comme une figure ornée de barbe (on la nomme aussi pour cela le Barbu); sa queue n’est ni très étendue ni très claire. Si j’ai bonne mémoire, après avoir contemplé hier cette comète, je crois qu’elle appartient au groupe de Saturne ou de Mercure, car elle m’a paru pâle et d’une couleur livide, d’un éclat affaibli, à peu près comme l’étoile de Saturne; sa queue n’est ni longue, ni bien brillante, mais, comme elle m’a semblé un peu frisée, qu’elle passait rapidement comme si elle suivait le mouvement du ciel ; je la rangerai plutôt parmi celles de Mercure. Je ne pourrai cependant rien affirmer de certain sur sa nature jusqu’à ce que je l’aie contemplée plus attentivement et que je l’aie examinée avec plus de réflexion. Quant à la position où je l’ai surprise, je dirai que son corps, hier soir, était suspendu vers la 3è étoile de la face du Lion, que sa queue s’étendait en ligne droite entre les deux dernières étoiles de la Grande Ourse vers l’étoile polaire, c’est-à-dire de l’Occident vers le Septentrion. Elle se mouvait d’un mouvement irrégulier, vibratoire pour ainsi dire, comme pour descendre et se coucher vers la droite.
Quant à ce qu’elle peut présager, il est nécessaire de le déduire de bien des considérations d’abord de la nature de la planète qu’elle imite, de la nature du signe sous lequel elle apparaît et se promène; en troisième lieu de la nature de l’astre ou de l’étoile Béhème de qui elle dépend ; il faut ensuite recenser les diverses naissances ou intronisations des Princes, les changements de règne, pour savoir si l’horoscope se rapporte à la nativité, à l’intronisation ou au changement de l’un d’eux; voir si, par hasard, il concorde avec le lieu du départ de l’astre, sa direction, ou le lieu hilech de quelque comète. S’il y a évidemment quelque chose de tel, on pourra conjecturer, pour ce prince, qu’il est menacé dans sa vie par un grand péril, ou dans ses honneurs, son trône, sa fortune. Ce qui s’applique aux Princes peut s’appliquer aussi aux commencements comme aux révolutions des royaumes. On peut en tirer aussi leurs horoscopes.
Voilà, cher et Révérend Père, ce que j’ai pu tirer de ma mémoire pour le confier tel quel à mon obligeante, mais faible plume. Vous m’aviez prié de vous répondre ce matin même; sans cela, j’aurais approfondi davantage la question à examiner; je le ferai encore si tel est votre bon plaisir, si j’en ai le temps et les livres nécessaires pour tout ce travail. Ce genre de divination exige, en effet, beaucoup d’exactitude. Celui qui n’a pas mesuré avec des instruments justes la déclinaison, la largeur, l’ascension droite ou oblique, la distance du soleil, du baromètre, son mouvement depuis le commencement de son apparition jusqu’à la fin, la disposition et les évolutions de sa queue, ne peut rien pronostiquer de certain. Pourtant je ne craindrai pas de dire que, de même que le corps de la comète annonce plus particulièrement l’avenir, de même la queue montre plutôt où les événements se passeront. Or, comme la queue de cette comète s’étend directement vers le septentrion, il y a certainement de là un péril qui menace, ou bien cela signifie que la réalisation de ces événements aura lieu dans ces régions ou dans leur voisinage.
Adieu. Que votre Paternité se porte le plus heureusement du monde. Je me recommande à elle très humblement.
Agrippa à Érasme.
Cologne, Ie 17 mars 1531.
Naguère j’ai répondu, illustre Érasme, à la lettre aimable m’aviez fait tenir par l’entremise que vous du prêtre Andréas. J’ai eu la précaution de confier ma réponse à Maximilien Transylva, mais je ne sais si vous l’avez reçue; je le crois pourtant, bien que je n’aie encore aucune nouvelle de vous. En effet j’étais loin du Brabant, je suis resté quelques jours auprès du Respectable et Illustre Prince-Electeur, Gouverneur de Cologne, qui professe envers vous une estime et une amitié singuli

La Bible traduite par Jacques Lefebvre d’Étaples
ère. Notre conversation roule souvent sur votre savoir si sûr, sur votre supériorité scientifique invincible. II y a en outre auprès de la personne du prince bien d’autres personnes qui chantent vos louanges, exaltent votre nom, entre autres Tillemann de Fosse, qui vous admire et vous aime le plus. Ce dernier m’ayant dit qu’il avait une excellente occasion auprès de vous, j’ai pensé qu’il serait mauvais de ne pas en profiter pour vous écrire.
N’ayant pas pour le moment autre chose à vous faire savoir je me borne à vous répéter que je suis toujours votre tout dévoué, votre bien obligé de votre initiative à parler en termes élogieux de ma personne dans vos lettres, quoique n’étant pas un homme connu et de grande valeur littéraire. Donc, puisque vous avez la bonté, vous, homme illustre, de ne pas dédaigner la correspondance d’un homme obscur, pardonnez à mon audace, si je vous prie de m’écrire quelque chose dans vos heures de loisir. J’espère toutefois que ce sera sous peu qu’il y aura entre nous matière à correspondance suivie sur d’importants sujets.
P.-S. Je dois rester ici encore un mois, je retournerai ensuite en Brabant.
Agrippa à son protecteur le Cardinal Laurent Campegio.
Bonn, novembre 1532.
Je sais devoir à votre Éminence une reconnaissance des plus vives, des plus durables, tant pour la bienveillance dont elle m’a toujours honoré et les bienfaits dont elle m’a comblé, que pour l’appui qu’elle m’a donné contre ces gens qui avaient irrité et presque tourné contre moi César [20] et sa cour, au point que j’en étais arrivé à deux doigts de ma ruine. Révérend Père, pardonnez-moi encore si j’emploie les termes les plus forts, l’invocation la plus ardente pour vous prier de me rendre encore de nouveaux services. Je viens aujourd’hui vous supplier, pontife vénérable, vous, si remarquable par votre science et votre piété, de ne pas vous déjuger dans la protection que vous voulez bien accorder à Agrippa, votre client depuis tant d’années. Daignez me continuer votre faveur. Ce qui me fait recourir à vos bons offices, c’est une nécessité qui me dispense de toute honte.
Par ordre de l’empereur et sur vos conseils, je dois me laver de l’accusation d’impiété. Il me faut donc affronter de véritables adversaires, livrer un vrai combat. Me taire, ce serait reconnaître que cette accusation est fondée si je n’en tiens pas compte, je porte un coup irrémédiable à ma bonne réputation. Il est extrêmement périlleux pour moi de reculer devant une bataille acharnée d’autre part, je ne puis le faire sans porter coups et blessures à mes adversaires. Aussi me semble-t-il très dangereux de descendre dans l’arène sans l’appui d’un protecteur d’une vaste et solide érudition, d’un jugement sûr et droit.
Voici donc mon Apologie contre les calomnies de quelques docteurs de Louvain. Sur la promptitude que j’ai apportée à y répondre il n’est pas de meilleurs témoins pour l’attester que l’honorable Seigneur Lucas Bonifius, votre secrétaire, qui a vu, qui a lu une partie assez grande de cette apologie; et le vénérable Don Bernard de Paltrinériis, majordome de Votre Éminence, dans la chambre duquel, par un travail assidu de nuit et de jour, je l’ai achevée si vite que, l’opuscule de mes adversaires m’ayant été présenté le 15 décembre [21], j’ai pu terminer mon apologie avant les dernières calendes de février. J’ai pu également la donner au Président du Parlement de Metz. Mais je ne devais pas la publier avant qu’un décret de ce même Sénat ne m’ait autorisé à la transcription de ces articles calomnieux contre moi. Malgré cela, le châtiment a devancé le jugement et l’instruction de cette affaire sans connaître la cause, sur de simples soupçons, j’ai été condamné par des gens qui, mettant de côté l’autorité du Parlement, se sont arrogé le droit de juger, gens qui, étant mes accusateurs et mes ennemis, ne cherchaient pas tant à me juger qu’à me faire perdre ma cause. Voilà plus de dix mois que j’attends en vain ce décret du Parlement. Je ne serai donc pas si prodigue de mon honneur, si cruel pour ma réputation, si lâche déserteur de mon innocence pour paraître accepter par mon silence une accusation si cruelle d’hérésie, d’impiété, de scandale, que ces hommes pervers, falsificateurs éhontés de mes écrits, ennemis acharnés de ma renommée m’ont lancées à la face.
Ne suis-je donc pas forcé, avant le jugement, de la publier après en avoir revu quelques passages et ajouté quelques compléments, tout cela sous l’autorité de votre nom ? Je le fais avec d’autant plus d’assurance que Votre Éminence m’a encouragé à répondre, à me laver d’accusations si horribles, en me recommandant toutefois modération et douceur. Par suite de cette dernière recommandation, je n’ai pu répondre avec autant de franchise, autant de véhémence que ces perfides calomniateurs l’avaient mérité. Ces gens-là, vous le savez bien, n’ont pas seulement procédé contre moi par des articles calomnieux ils ont adopté aussi mille moyens détournés pour me nuire en secret, allant jusqu’à des accusations capitales, employant des ruses, des fourberies assaisonnées d’aconit, subornant l’un et l’autre. Ils ont répandu contre moi tant de venin mortel soit à la Cour de l’Empereur auprès de puissants personnages, soit dans les chaires devant une foule ignorante, qu’il m’est difficile de garder mon sang-froid en face de persécutions si odieuses. Certaines de leurs calomnies sont telles qu’elles feraient sortir de son naturel l’homme le plus patient puis-je, dois-je même y rester insensible ? Aussi, dans la dite Apologie, si je parle un peu trop librement contre ces gens malfaisants, ne suis-je pas en droit de le faire, d’autant plus que je ne cache point mon nom et que l’Empereur m’a donné ordre de me défendre contre ces calomnies, ces accusations, ces injures ?
Du reste, ils les ont répandues au mépris de toute autorité en anonymes, en m’attaquant lâchement par derrière. Certes, je n’ignorais pas, au début de ma déclamation 3, que je récolterai la haine comme récompense de mon savoir, que je rencontrerai, étant opposé à leurs opinions, la férocité sauvage des Gymnasiarques, la politesse hypocrite des Sophistes, la fureur de nos Professeurs, les embûches des Scolastiques, les ruses des pseudo-Moines. J’avais bel et bien prévu tout cela; mais jamais je n’aurais pu m’imaginer que, contre l’habitude des gens érudits et honnêtes, ils ne se contenteraient pas de discuter simplement mes idées, de prendre la plume pour détruire mes conclusions, ou de me provoquer à une discussion solennelle et publique, sans avoir recours à des insinuations perfides, à d’insignes calomnies pour me flétrir dans la bonne opinion de l’Empereur. Je n’ai pu ainsi leur faire voir ce dont j’étais capable comme s’ils avaient écrit et discuté ouvertement contre moi. À coup sûr, je ne redoute point leur science, mais je crains leur violence. Je n’ignore pas quel danger je cours au milieu de cette meute d’ennemis contre lesquels la lutte que j’ai entreprise me semble devoir être éternelle, surtout lorsque je vois que leur incroyable tyrannie reste impunie. Or les professeurs d’Universités avaient coutume autrefois de me convier à des discussions publiques ; – confus maintenant de l’insuffisance de leur savoir, ils les ont prises en horreur et prétendent vaincre par la violence ce qu’ils devraient réfuter par le raisonnement. Je connais ceux dont dépend l’opinion de César, quels sont les Théologiens qui l’assistent ; je sais combien la vérité est odieuse, mais elle triomphera devant un juge équitable ; l’innocent ne sera pas effrayé par l’accusation ; il est cependant pénible et dangereux de plaider sa cause par devant ses adversaires.
Si l’Empereur était au courant de toutes les circonstances concernant mon affaire, de toutes les injures que j’ai reçues, s’il connaissait mes écrits par lui-même, peut-être son esprit serait-il mieux disposé à mon égard ; il ne me regarderait pas comme le dernier des hommes ; -mais, la plupart du temps, à la Cour des rois, la méchanceté des détracteurs a plus de puissance que le crédit des gens de bien. Celui qui calomnie n’est pas seulement coupable, mais encore celui qui prête l’oreille à la calomnie.
Ces accusations ne m’auraient certainement pas atteint, ces mauvaises langues n’auraient pas réussi à me nuire, si elles n’avaient pas rencontré des oreilles ouvertes au mal. Mais j’ai confiance en mon innocence. Je ne serai point convaincu de crime et je ne fais qu’un seul vœu celui d’avoir un juge à la fois intelligent et impartial, comme vous, par exemple. En conséquence, je prie et supplie à nouveau Votre Éminence de ne pas me fermer son cœur, et, bien que vous soyez accablé d’affaires nombreuses et des plus importantes, qu’elle m’accorde un peu de son temps pour prendre connaissance de mes écrits et de mes réponses, jusqu’à ce qu’elle possède à fond ma cause. N’envisagez pas avec peine que je vous réclame comme mon protecteur dans un procès que, sans doute, bien des gens vous dépeindront comme odieux. Il ne peut vous déplaire de lutter contre de perfides faussaires, contre des sycophantes impies et criminels, pour prendre la défense de la Piété et de la Bonne Foi. Fasse Dieu que son Église soit purgée de la souillure de tous ces hérétiques et des ténèbres des Sophistes ! Puisse-t-elle recouvrer son antique splendeur ! Puissiez-vous y trouver vous-même salut, gloire et prospérité ! Adieu, le plus cher des amis.
Illustrations :
- Jacques Lefebvre d’Etaples : https://www.musicologie.org/
- Couronnement de Charles-Quint : http://www.culture.gouv.fr/
- La Bible traduite par Jacques Lefebvre d’Etaples : http://www.museeprotestant.org/
* * * * *
Notes
[1]. Cette date de naissance hypothétique de Jacques Lefebvre d’Etaples est donnée par la base de données de la Bibliothèque nationale française ; ce savant était le premier à traduire la Bible en français et l’Église voyait cela d’un mauvais œil car elle avait peur que le commun des mortels interprète mal les épisodes ou les allusions contenues dans le Livre Saint : « Elle y voit un risque d’hérésie, si chacun se met à interpréter la Bible à sa manière en se coupant de la tradition développée depuis les Pères de l’Église. » Rappelons aussi que « en 1526, le Parlement de Paris interdit toute traduction de l’Écriture en français ».
[2]. Célèbre moine anglais (1214-1292) qui avait des connaissances profondes en mathématiques, en physique et en chimie, non moins qu’en grec, latin, hébreu, en droit, etc. Surnommé le Docteur admirable, il avait étudie à Oxford et à Paris.
[3]. Savant dominicain et philosophe scolastique, né en Souabe (1193-1280). Il était si versé dans les études d’histoire naturelle qu’il passa pour magicien. Avec son disciple saint Thomas, il passa 3 ans à Paris et connaissait toutes les sciences de son temps et tous les livres des philosophes latins et arabes.
[4]. Tritheme ou Tritheim, chroniqueur et fécond théologien, né à Trittenheim près de Trèves, habita Spannheim puis Vurzburg (1462-1516)
[5]. Philosophe néoplatonicien (205-270). Ses Ennéades furent traduites en latin par Marcile Ficin, avant la publication du texte, Florence, 1492.
[6]. Ou de l’eau à la rivière. Proverbe tiré de Cicéron.
[7]. Chapuys, d’Annecy, était alors Official de Genève, sous l’évêque Jean-Louis de Savoie
[8]. Faber Stapulensis (1455-1536). Sa dissertation, publiée en 1517, pour prouver, contrairement à l’opinion des docteurs de l’époque, que Marie-Madeleine, Marie sœur de Lazare et la Madeleine pécheresse étaient 3 personnes distinctes, dissertation condamnée par la Sorbonne, fut défendue énergiquement par Agrippa. Le Père Dieudonné leur servit de messager, comme cette lettre et d’autres en donnent le témoignage. Il en est de même pour la question de sainte Anne.
[9]. Dieudonné était religieux célestin à Paris en 1519, puis à Metz où il se rencontra avec Agrippa dans une conférence théologique au couvent des Célestins de cette ville, et eut d’amicales relations avec lui. Il en fut réprimandé par les supérieurs de son ordre et envoyé au couvent d’Annecy.
[10]. Voir la note 6 précédente.
[11]. Claude Dieudonné, voir aussi la note 7 précédente.
[12]. Le Père Dieudonné avait passé de Metz, où il fut réprimandé pour ses relations avec Agrippa, au couvent d’Annecy en Savoie, voir la note 7.
[13]. Barbues
[14]. Pointues
[15]. Ailées
[16]. Poilues
[17]. Cornues
[18]. En forme de lampes
[19]. Chevelues
[20]. Charles-Quint
[21]. Le 15 décembre 1531
[22]. De vanitate scientiarum et artium.
* * * * *



